Les statues meurent aussi
Alain Resnais, Chris Marker, Ghislain Cloquet (1953)
Respect, admiration totale pour ce documentaire sur ce que l'on nommait encore dans les années cinquante l'art nègre, un terme revendiqué avec fierté et non sans provocation par Aimé Césaire et Léopold Sédar Senghor pour désigner l'identité africaine dans les années 30. Commandé par la revue "Présence africaine", il est réalisé par deux immenses cinéastes, Alain Resnais et Chris Marker, assistés du chef-opérateur Ghislain Cloquet.
La culture noire-africaine malmenée, menacée par la colonisation est au cœur de ce court-métrage qui allie la beauté esthétique au discours politique engagé. Les œuvres sont filmées de manière exceptionnelle, mises en valeur par l'éclairage et la science du montage dont Resnais et Marker ont le secret. Elles acquièrent ainsi une dignité que l'occident leur refusait à l'époque (le point de départ du documentaire n'est-il pas une interrogation sur le fait que l'art grec et égyptien se trouvaient au Louvre alors que l'art nègre devait se contenter du musée de l'Homme, comme un écho ségrégationniste à l'art "dégénéré" vilipendé par les nazis?) Quant au texte de Marker, lu par Jean Négroni, il s'interroge sur le mystère de ces œuvres, sur la culture qui les a produite "au temps de Saint Louis" et dont nous ne savons rien puisqu'elle était de tradition orale. Et il dénonce les ravages de la colonisation qui a mis sous vitrine (c'est à dire empaillé) les vestiges qui lui sont tombés entre les mains tout en éradiquant la source de nouvelles productions en imposant sa propre culture. Les monuments aux morts et la statuaire chrétienne ont balayé l'art africain sur le sol même de l'Afrique quand ce n'était pas l'islam qui le détruisait au nom de l'interdiction des images.
Produit peu de temps avant la décolonisation de l'Afrique, le documentaire de Resnais et Marker est censuré pendant 11 ans car la France n'admet pas les critiques sur son modèle colonialiste assimilationniste (même si cet assimilationnisme reste largement une chimère) et tente d'empêcher ses colonies d'obtenir leur indépendance, soit par la ruse, soit par la force comme en Algérie. Elle ne lâchera prise que lorsque la décolonisation de son Empire africain sera achevée.

/image%2F2429364%2F20240414%2Fob_e5b950_celebrating-agnes-varda-67536518371101.png)










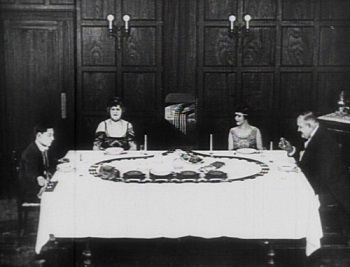

/image%2F2429364%2F20220209%2Fob_32c62c_hqdefault.jpg)