Rendez-vous (The shop around the corner)
Ernst Lubitsch (1940)
Lubitsch est surtout connu en France pour ses comédies sophistiquées et piquantes situées dans des milieux aisés, dilettantes et oisifs (comme "Haute pègre (1932)", "La Huitième femme de Barbe Bleue (1938)", "Le Ciel peut attendre (1943)", "Sérénade à trois (1933)" etc.) Mais c'est à une autre veine, plus sociale et humaniste qu'appartient "The shop around the corner" qui après une discrète sortie en 1945 fut invisible en France jusqu'en 1986 avant de connaître un triomphe lors de sa ressortie (sous son titre original) au cinéma "Action Christine" à Paris.
"The shop around the corner" (l'ayant moi-même découvert sous son titre en VO j'ai beaucoup de mal à employer le titre français "Rendez-vous") est l'adaptation d'une pièce de théâtre de Miklós László, "Parfumerie". Cette origine théâtrale est très palpable dans le film (unité de lieu, décors de cartons pâte) car c'est l'univers dont Lubitsch est issu et qu'il maîtrise sur le bout des doigts avec notamment un sens du rythme imparable et des dialogues parfaitement ciselés. Il lui rendra d'ailleurs un hommage éclatant deux ans plus tard avec l'un de ses films les plus célèbres "Jeux dangereux (1942)" qui lui aussi est plus connu sous son titre original "To be or not to be (1942)".
D'autre part le film se déroule dans un milieu beaucoup plus modeste que celui que Lubitsch a l'habitude de montrer, celui d'une boutique de maroquinerie à Budapest où cohabitent un patron dépressif et des employés précarisés par la peur du chômage et de la misère. Une misère qui n'est pas seulement matérielle mais aussi sentimentale. Lubitsch délaisse le cynisme qu'il emploie lorsqu'il dépeint la haute société pour un humanisme proche du style de Frank CAPRA. La comparaison est d'autant plus pertinente que Lubitsch emprunte pour le rôle majeur d'Alfred Krulik, James STEWART dans un rôle très proche de ceux dans lesquels il a joué pour Frank CAPRA .
La boutique de Hugo Matuschek (Frank MORGAN) où se déroule l'histoire apparaît comme un refuge. Elle abrite une petite communauté soudée et chaleureuse, capable de surmonter les épreuves grâce à l'entraide entre ses membres. Seul celui qui sème la discorde (Joseph SCHILDKRAUT) finit par être impitoyablement chassé. Epreuves externes mais surtout internes car les personnages principaux, complexes et nuancés ont une tendance autodestructrice assez affirmée. Le quiproquo qui occupe une place centrale dans le film n'est qu'un paravent comique qui dissimule la difficulté à entrer en contact et communiquer. La relation filiale entre Matuschek et Krulik ainsi que la relation amoureuse entre Krulik et Klara Novak (Margaret SULLAVAN) se construisent dans la douleur, l'humour n'étant que la politesse du désespoir.

/image%2F2429364%2F20240414%2Fob_e5b950_celebrating-agnes-varda-67536518371101.png)









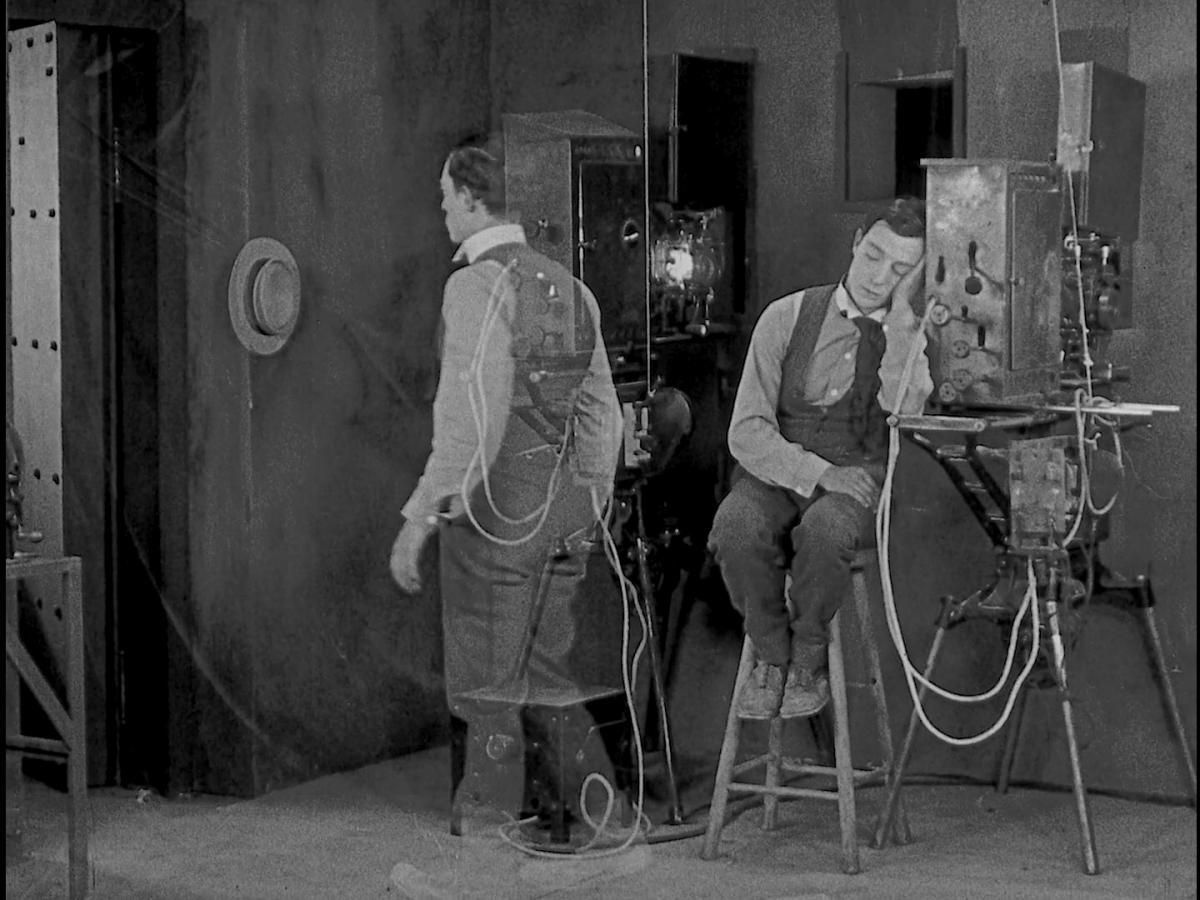


/image%2F2429364%2F20220209%2Fob_32c62c_hqdefault.jpg)